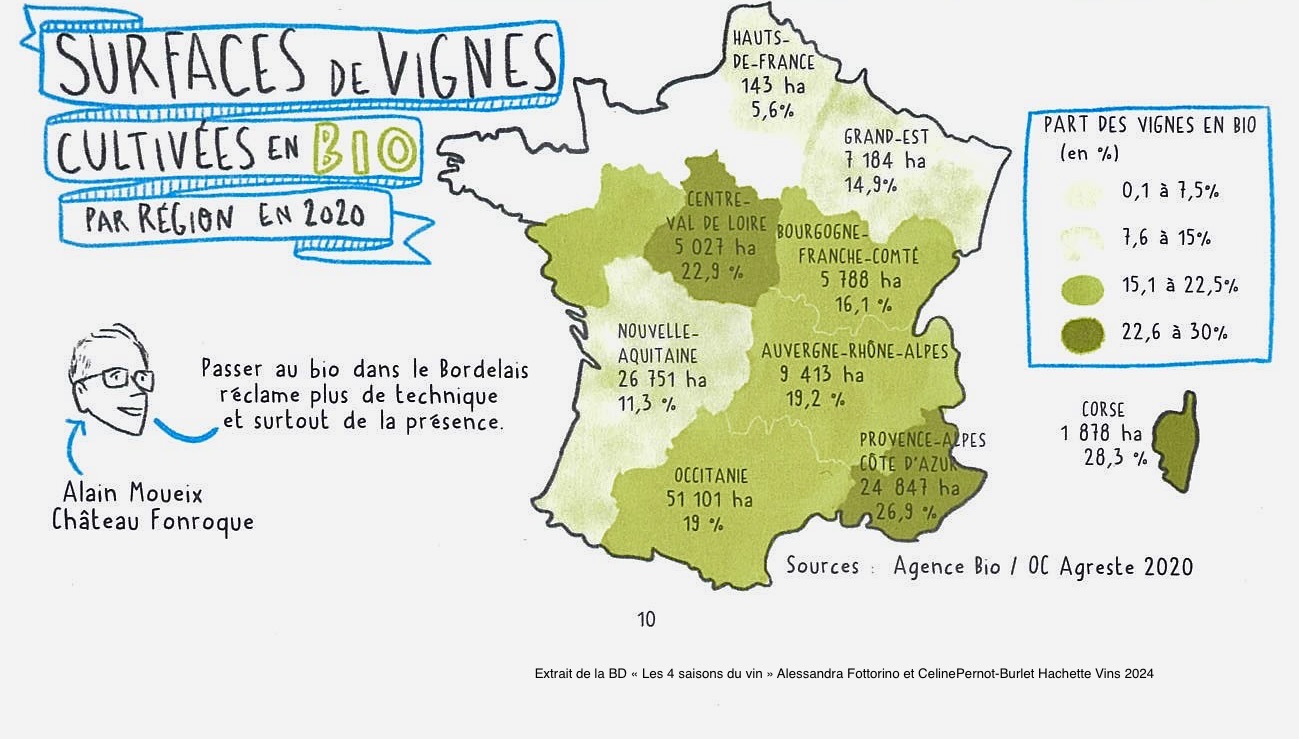La Viticulture Biologique
La viticulture biologique est une méthode de culture de la vigne qui respecte les principes de l’agriculture biologique.
Elle exclut l’usage de produits chimiques de synthèse (comme les herbicides, insecticides ou fongicides) et favorise les pratiques naturelles pour entretenir les sols, prévenir les maladies et protéger la biodiversité.
Principes de la viticulture bio
- Pas de produits chimiques de synthèse : utilisation de produits naturels comme le soufre ou le cuivre contre les maladies.
- Fertilisation organique : compost, fumier ou engrais verts pour enrichir les sols.
- Préservation de la biodiversité : haies, enherbement, cultures associées pour favoriser les auxiliaires naturels.
- Travail du sol raisonné : labour léger ou enherbement pour limiter l’érosion.
- Vinification bio : en cave, les intrants sont également réglementés (levures, sulfites, etc.).
La Biodynamie en viticulture
Cette approche viticole repose sur la prévention, permettant à la plante de développer ses propres mécanismes de défense face aux agressions, grâce à un état de santé optimal.
La vitalité des plantes est maintenue par des préparations à base de plantes et d'autres substances naturelles.
La promotion de la biodiversité au sein des vignes est une priorité. Les sols sont peu ou pas travaillés, favorisant ainsi une vie biologique active, incluant des enzymes, des bactéries et des vers de terre.
Les cycles lunaires sont également intégrés dans les pratiques culturales.
Dans le chai, l'utilisation de soufre est soigneusement réduite.
- Cette méthode se distingue par son respect de l'environnement et de la santé des vignerons, allant au-delà des principes de l'agriculture biologique en approfondissant la compréhension des plantes et de leurs interactions avec leur écosystème.
- Elle requiert une surveillance continue des vignes et une expertise suffisante pour gérer les maladies sans recourir à des produits chimiques. Les rendements peuvent souvent être inférieurs à ceux des méthodes conventionnelles.
- De plus, cette approche exige une disponibilité considérable de la part du vigneron pour intervenir au moment opportun, ainsi qu'une main-d'œuvre significative. Cela engendre un niveau de risque élevé.
- Certaines pratiques, qui ne reposent pas toujours sur des fondements scientifiques rigoureux, peuvent apparaître comme « ésotériques » et fantaisistes aux yeux des non-initiés.
Le principe de cette agriculture est basé sur les théories de Rudolf Steiner (1861-1925), enrichies par toutes sortes d'approches et d'expériences.
Le Vin Nature
Le « vin nature » n'a pas de définition légale ni incontestable mais une variation d'acceptions à partir d'un principe commun, l'opposition aux vins contenant des additifs.
L'oenologue-négociant André Jullien (1766-1832) le définit déjà en 1816 dans Topographie de tous les vignobles connus : « Un vin naturel est celui dans lequel on nà introduit aucune substance qui lui soit étrangère. »
Il insiste sur la pureté chimique, comme un groupe de producteurs allemands qui, pour promouvoir leurs vins « naturels », c'est-à-dire sans adjonction de sucre, fondent en 1910 le Verband Deutscher Naturweinversteigerer, l'association des producteurs allemands de vins naturels. qui deviendra l'actuel VDP (Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter).
Quelques années plus tôt. en Languedoc-Roussillon, la révolte tragique des vignerons porte sur le retour des vins naturels (« Le vin doit être la fermentation du pur jus de la vigne ! ») par opposition aux « vins de sucre » et aux vins trafiqués.
L'expression réapparaît au début des années 1980, cette fois par opposition aux vins « technologiques » recourant non plus juste au sucre mais à des intrants oenologiques afin de les stabiliser et de les standardiser. Mais cette fois la démarche prend aussi en compte la viticulture.
C'est en constatant les difficultés de fermentation des moûts de beaujolais que Jules Chauvet (1907-1989), chimiste et négociant en vin, fait le lien entre les excès de la viticulture industrielle, la qualité des raisins, la nécessité supposée d'additifs et le goût des vins.
Après des décennies de travaux, il formalise les conditions nécessaires en vigne et au chai pour effectuer des vinifications naturelles sans intrant (levures indigènes, absence de soufre), inspirant les pionniers du mouvement, tels Marcel Lapierre ou Pierre Overnoy, guidés par Jacques Néauport. Jamais pourtant Chauvet n'utilise l'expression « vin naturel » dans ses publications.
Aujourd'hui, les définitions contemporaines gravitent autour d'un axiome commun: Issu au minimum d'une viticulture ne recourant pas aux produits de synthèse (biologique, biodynamique, etc.). le vin naturel est produit sans additif chimique ni technique physique traumatisante (osmose inverse, centrifugation, flash pasteurisation, etc.). Seule une dose minimale de dioxyde de soufre (SO,) est tolérée.
Devant le succès commercial de cette production, des chartes ont vu le jour : celles de l'AVN (Association des vins naturels), qui lait la première de son genre, ou de Vins SAINS (Sans Aucun Intrant Ni Sulfite).
La dernière créée. Vin Méthode Nature, est la seule aujourd'hui en France à avoir fait valider la possibilité de la mentionner « méthode nature » sur les étiquettes pour les producteurs qui sengagent à l'appliquer et se faire contrôler par un organisme tiers.
Extrait « Mille Vignes » Pascaline Lepeltier (Hachette vins 2022)
Les CMR : c'est quoi?
"C" pour "Cancérogène", "M" pour "Mutagène", "R" pour "Reprotoxique"...
Trois mots qui font frémir !
Ces substances chimiques, dangereuses pour l'environnement et la santé humaine, sont omniprésentes dans les produits phytosanitaires. Elles augmentent le risque de développer des cancers et affectent la fertilité. On les classe en CMR1 (risque avéré pour l'homme et/ou les animaux) ou en CMR2 (suspicion de risques).
Certaines régions viticoles, comme Bordeaux, souhaitent les bannir bien qu'encore disponibles sur le marché.
Elles sont acceptées par des labels tels que HVE.
Cette situation est inacceptable pour les vignerons bio ou biodynamiques : c'est pourquoi sept associations ont déposé une requête auprès du Conseil d'État le 20 janvier 2023, demandant l'interdiction du label HVE.
Les Pesticides
Il s'agit des substances chimiques employées pour protéger les ceps et les raisins des menaces potentielles.
- Les insecticides sont utilisés pour éliminer les insectes nuisibles.
- Les fongicides sont destinés à lutter contre les champignons, souvent causés par un excès d'humidité.
- Les herbicides servent à supprimer les mauvaises herbes qui peuvent rivaliser avec la vigne ou favoriser l'humidité si elles poussent trop hautes.
Le Soufre et le Vin
Le soufre est un additif traditionnellement utilisé dans la vinification, et sa présence est mentionnée sur les étiquettes par l'indication « contient des sulfites ».
Cependant, son utilisation suscite aujourd'hui des interrogations croissantes.
Les vignerons engagés dans l'agriculture biologique, la biodynamie, ainsi que ceux qui défendent les vins naturels, qui n'utilisent aucun additif, s'efforcent de réduire significativement l'utilisation de soufre, voire de s'en passer totalement.
C'est quoi le soufre ?
Le soufre, également désigné sous le nom de dioxyde de soufre (SO2) ou anhydride sulfureux, est un composé chimique dérivé de l'industrie pétrolière. Bien qu'il soit naturellement présent dans les sols volcaniques, il demeure relativement rare.
Son rôle ?
- Antioxydant : il préserve le vin de l'oxydation causée par l'air.
- Antiseptique : il élimine les bactéries indésirables.
- Il interrompt le processus de fermentation.
Quand L'utiliser ?
- Lors de la vendange, le soufre protège les raisins de l'oxydation et d'une fermentation prématurée.
- Au cours de la vinification, il permet de réguler la fermentation.
- Avant le stockage du vin dans les barriques, une mèche de soufre est brûlée pour désinfecter le bois. Le dioxyde de soufre pénètre dans le bois et se transforme en sulfites lors du remplissage.
- À l'embouteillage, il protège le vin de l'oxydation et contribue à sa stabilité.
Que lui reproche t-on ?
- L'abus de soufre par certains producteurs peut être motivé par la facilité, notamment pour masquer des défauts aromatiques liés à des raisins altérés.
- Il est perçu comme un allergène potentiel, ce qui rend son étiquetage obligatoire.
- En excès, il peut entraîner des maux de tête.
- Il peut également limiter l'expression des arômes du vin.
Le véritable enjeu réside dans le dosage du soufre, plutôt que dans le soufre lui-même.
Comment s'en passer ?
L'absence de soufre nécessite des vignes en bonne santé, un tri rigoureux pour éliminer toute pourriture, une hygiène impeccable dans le chai, ainsi qu'un suivi minutieux des cuves ou une filtration approfondie des vins.
Pour protéger les vins de l'oxydation, certains vignerons adoptent des méthodes telles que la vinification à basse température, l'utilisation de gaz inerte, ou l'ajout d'une petite quantité de gaz carbonique lors de l'embouteillage.
Comment identifier un vin sans soufre ?
Les étiquettes peuvent comporter les mentions suivantes : « sans soufre ajouté », « sans sulfites ajoutés », « nature », ou « Aucun soufre n'a été ajouté durant le processus de vinification et à l'embouteillage. »
Il est à noter que le vin peut contenir une faible quantité de soufre, car il en produit naturellement lors de la fermentation, mais ce soufre diffère de celui qui est ajouté.
Et le goût du vin ?
Le vin peut contenir une légère quantité de gaz carbonique, qui s'échappe lors de l'aération ou en remuant délicatement la bouteille.
Le vin est plus sensible : il risque de se dégrader s'il est soumis à des variations de température importantes ou s'il est conservé à une température trop élevée (au-delà de 14 à 16 °C).
Les principaux labels associés
1. Label AB (Agriculture Biologique – France)
- Géré par l’État français.
- Garantie que le vin est issu de raisins cultivés selon les règles bio.
- Vinification aussi contrôlée (sulfites limités, levures sélectionnées autorisées…).
- Nécessite une conversion de 3 ans avant certification.
2. Label Eurofeuille (Label Bio Européen)
- Remplace ou accompagne souvent le label AB.
- Même cahier des charges que le label AB, reconnu à l’échelle européenne.
- Obligatoire pour tout produit bio préemballé en Europe.
3. Demeter (Biodynamie)
- Certification spécifique aux méthodes de l’agriculture biodynamique (au-delà du bio).
- Utilisation de préparations biodynamiques, prise en compte des rythmes lunaires et planétaires.
- Exigences strictes en cave également.
- Très reconnu internationalement.
4. Biodyvin
- Autre certification en biodynamie, spécifique aux domaines viticoles.
- Moins généraliste que Demeter, plus orienté viticulture de qualité.
- Créé par le Syndicat International des Vignerons en Culture Biodynamique.
5. Nature & Progrès
- Label historique, très exigeant, souvent plus strict que les labels bio officiels.
- Basé sur une charte éthique et écologique, avec engagement collectif.
Il n’existe pas encore de label officiel public pour les vins naturels, mais certaines associations professionnelles ont mis en place des chartes très encadrées
6. Vin Méthode Nature
- Premier label reconnu officiellement par l’INAO en France (mais non réglementé par la législation européenne).
- Créé en 2020 par le Syndicat de défense du vin nature.
- Exige :
- raisins bio certifiés,
- vendanges manuelles,
- vinification sans intrants (levures indigènes uniquement),
- pas ou très peu de sulfites (max 30 mg/L pour les rouges),
- pas de filtration ni de collage.
7. AVN (Association des Vins Naturels)
- Réseau de vignerons engagés dans le vin naturel.
- Pas un label apposé sur la bouteille, mais une charte commune :
- bio ou biodynamie,
- vinification sans intrants,
- transparence sur les pratiques.
8. S.A.I.N.S. (Sans Aucun Intrant Ni Sulfite ajouté)
- Label très strict fondé sur le “zéro ajout”, même pas de sulfites.
- Vinification 100 % naturelle, sans aucun traitement chimique ou œnologique.